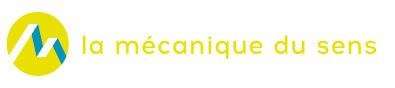C’est installé dans mon moelleux canapé, une tasse de thé fumante à la main, que la terrible nouvelle tombe. Un article de Science & Vie* (version papier) m’apprend que l’activité numérique est responsable de près de 8% de la consommation d’électricité dans le monde et de 4% de la production de CO2. Plus que le transport aérien ou maritime. Que le premier pourcentage pourrait passer à 20 d’ici à 6 ans. Que les compteurs ne vont faire que s’affoler.
Notre consommation effrénée de « nouvelles technologies », de « nouveaux usages » ne fait qu’empirer ce triste constat. En effet, on ne se rend même plus compte, avec les puissances de calcul et les vitesses de transfert, du poids de l’information. Regarder une vidéo en streaming (on pointe Netflix du doigt, mais YouTube n’est pas en reste !), parler à son assistant digital (qui mobilise des programmes, appelons-les des IA même si on est bien loin du Neuromancien**) ou traiter de la donnée en masse mobilisent des milliers de data centers. Bien sûr, ils sont construits dans des régions de plus en plus boréales, l’énergie dissipée est souvent récupérée ; dans le même temps, de nouveaux matériels moins énergivores sont développés. Mais ces améliorations permettront-elles d’éviter le drame ?
Dans nos métiers de la communication, de la publicité et des médias, nous sommes aux premières loges, ou plutôt sur le devant de la scène. Si chaque geste compte, alors nous pouvons nous interroger sur nos usages et, notamment, sur cette avalanche de mails que nous déclenchons. Encore plus sur ceux qui recèlent des pièces jointes de plus en plus nombreuses, de plus en plus lourdes. Je ne m’exonère pas de l’ensemble, loin de là, je suis même le premier à accompagner mes messages d’un petit GIF animé amusant, régulièrement.
Au-delà de la boutade, il conviendrait que chacun puisse faire attention à ses envois, à ses demandes et à ce qu’il attend en retour. Combien de fois échangeons-nous dix mails là ou deux ou trois auraient suffit ? Relisons-nous, rassemblons les informations, accordons-nous quelques instants de plus pour éviter ces envois fragmentés ou répétés. Evitons le message de réponse automatique qui génère des cascades de mails inutiles. Soyons moins poli (il est toujours agréable de recevoir un « merci «, mais peut-être faut-il en perdre l’habitude) ou moins angoissé (quelqu’un qui ne répond pas dans l’heure n’a peut-être tout simplement pas eu le temps de répondre…).
Et je ne parlerai pas ici du stockage des mails datant de 2015 qui encombrent des millions de boîtes, assurant là aussi une belle gabegie énergétique.
À La mécanique du sens, nous sommes réactifs, polis et respectueux des autres. Mais au célèbre « N’imprimez pas ce mail pour protéger l’environnement », nous apposerons peut-être désormais en signature un « Si on ne vous répond pas – tout de suite –, c’est peut-être une bonne chose pour l’environnement. Et on s’occupe de vous, soyez-en sûr «.
Bon, je crois qu’il est temps de se refaire une tasse de thé…
Bonne com’ !
* Science & Vie n° 1219, avril 2019.
** William Gibson, Neuromancien, J’ai Lu. Ce roman, écrit en 1984, a cristallisé les canons du mouvement cyberpunk et décrivait un monde alors dystopique où régnaient en maîtres des multinationales qui se livraient une guerre impitoyable au cœur du « cyberspace «. Ça vous rappelle quelque chose ?